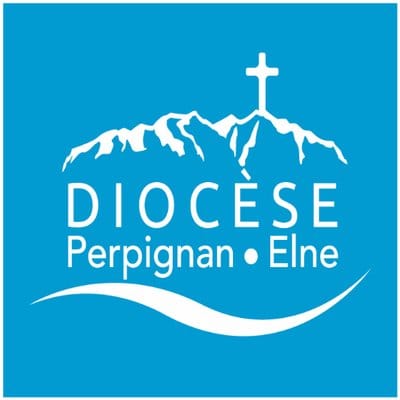Ce dimanche 26 octobre, la communauté paroissiale de Céret était réunie dans la joie pour la messe d’installation du Père Olivier Segond.
Dans son homélie, Mgr Scherrer s’est appuyé sur l’Évangile du jour : la parabole du pharisien et du publicain, pour inviter les fidèles à entrer dans une prière authentique, faite d’humilité et de confiance en la miséricorde de Dieu.
Il a ensuite exprimé des mots de fraternité et d’encouragement à l’égard du Père Olivier Segond.
Retrouvez ci-dessous l'homélie de l'évêque, ainsi que quelques photos de cette célébration.




Frères et sœurs, chers amis,
Nous avons encore à l'esprit l'évangile de dimanche dernier où le Seigneur, avec la parabole de la veuve importune, faisait l'éloge de la persévérance dans la prière. En ce 30ème dimanche, l'évangile des deux hommes qui prient dans le Temple, le pharisien et le publicain, vient compléter cet enseignement de Jésus en nous montrant quelle prière monte véritablement jusqu'à Dieu et touche son coeur.
Déjà, l'attitude des deux hommes souligne la différence. Regardons le pharisien, tout d’abord : il occupe l'avant-scène et représente le judaïsme préoccupé avant tout de l'observance scrupuleuse de la Loi. Il se tient « debout », la tête haute, comme si le Temple lui appartenait. Son attitude n'est pas en soi un signe d'orgueil : chez les juifs, en effet, la position debout est une position normale pour la prière. Ce qui est moins normal, en revanche, c'est que ce pharisien est tout entier tourné vers lui-même, dans un monologue intérieur qui ne ressemble en rien à une véritable acte de foi ; l'évangile nous dit qu’il prie « en lui-même » : il ne prie pas Dieu, en réalité, mais il fait son apologie devant Dieu. D’une part, il se glorifie de respecter les commandements en se comparant aux autres hommes qui ne sont, à ses yeux, que de misérables pécheurs avec lesquels il se félicite de n'avoir rien en commun. Et puis, nous le voyons étaler avec complaisance ses pratiques pieuses qui dépassent largement ce que prescrit la Loi : « Je jeûne deux fois par semaine, je verse le dixième de tout ce que je gagne, « je, je, je ». L’égo de ce pharisien est comme un bloc sans fissure dans lequel Dieu lui-même est comme empêché d’ouvrir une brèche… parce que cet homme, au fond, ne perçoit aucune faille dans sa conduite, et donc il n'a aucun besoin de la miséricorde de Dieu. La conclusion, le pharisien l'impose à Dieu en exigeant implicitement de Lui qu’Il admire sa justice et l'en félicite.
Regardons maintenant le publicain. Tant par son attitude que par ses mots, il se présente dans sa vérité de pécheur et implore miséricorde, bien conscient d'avoir franchi le seuil d'une maison qui lui est étrangère. Il « se tient à distance », nous dit saint Luc, comme s'il se sentait indigne de paraître devant Dieu. Du coup, les mots qu’il emploie sont ceux des psaumes de pénitence pour supplier Dieu de le prendre en pitié, car il ne trouve en lui-même que péché : « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ! ». C’est magnifique, car ce croyant réagit comme un homme qui n'aurait pas droit à l'amour de Dieu ; et pourtant, s’il est venu, c’est parce qu’il sait que l'amour n'est pas une question de droit, c'est un don absolument gratuit et immérité dont la source est en Dieu. C'est cet acte de foi et d’espérance qui va toucher Jésus au cœur : c'est lui, déclare-t-il, qui est devenu un homme juste, et pas le pharisien. « Qui s'élève sera abaissé ; qui s'abaisse sera élevé ». Quiconque, en effet, prend pour but ultime sa propre perfection, ne trouvera jamais Dieu ; mais celui qui a l'humilité, au contraire, de laisser la perfection de Dieu devenir agissante en lui sera, aux yeux de Dieu, un « justifié ». C'est la conviction que vient confirmer la première lecture : « La prière du pauvre traverse les nuées », nous disait Ben sirac le Sage. Le pauvre dont il s'agit n'est pas celui qui n'a pas d'argent, mais celui qui a conscience d'être pauvre en vertu, de ne pas correspondre à ce que Dieu demande de lui.
Cette histoire que nous relate l’évangile évoque des mentalités réelles que le Christ a rencontrées en Palestine. On comprend mieux alors pourquoi le Seigneur s'est heurté à une opposition aussi obstinée de la part des pharisiens, et pourquoi aussi il s'est compromis en la compagnie des publicains et des pécheurs. En partageant leur repas, il leur révélait le vrai visage de Dieu, visage tellement occulté par la religion officielle. De leur côté, ces publicains, marginalisés par la société bien-pensante, se sentaient enfin reconnus par quelqu'un qui refusait de les identifier à leurs péchés. Sans illusion sur leur valeur morale, ces publicains découvraient avec émerveillement, à travers Jésus-Christ, un Dieu différent, miséricordieux, prêt à les accueillir dans son Royaume.
Mes amis, s'il est vrai que cette parabole est pour nous, s’il est vrai qu’elle vaut encore pour nous aujourd'hui, la question se pose alors de savoir dans quel état d'esprit, dans quelle disposition intérieure nous avons franchi tout à l'heure le seuil de cette église. Était-ce pour faire le compte de nos mérites, à la manière de ce pharisien imbu de sa personne ? Ou bien était-ce pour nous présenter devant Dieu, tels que nous sommes, en implorant comme des mendiants le don de sa miséricorde ? Ce n'est pas par hasard si la liturgie de la messe commence justement par une demande de pardon : « Seigneur, prends pitié, O Christ, prends pitié, Seigneur prend pitié ». La tentation, le grand danger pour les chrétiens que nous sommes, c'est de prétendre être l’artisan de sa propre perfection : on entretient le mythe de l'autojustification. Or, le Christ seul est notre Sauveur, seul, il nous justifie, seule sa croix nous libère de l'esclavage du péché.
Cette parabole, au fond, est la parabole de la maturité chrétienne. C’est un fait que, les années passant, lorsqu'on jette un regard sur le chemin parcouru, on mesure l'écart, l'abîme même, qui sépare ce que nous avons rêvé d'être et ce que nous sommes réellement. Avec le recul suffisant, et en examinant aussi sincèrement que possible notre conscience, nous percevons avec plus de lucidité comment le mensonge s'est installé peu à peu dans nos vies et avec quel peu d'amour nous avons vécu nos relations avec les autres. Y a-t-il parmi nous quelqu'un qui puisse s’estimer quitte envers les exigences de l'évangile et, singulièrement, avec les exigences de l'amour ? Il ne s'agit pas, bien entendu, de nous flageller, de nous imaginer pires que ce que nous sommes en réalité ; il s'agit d'emprunter le chemin de la conversion, le seul qui puisse attirer sur nous la miséricorde de Dieu et nous conduire ainsi à la paix véritable. C'est cette foi humble du publicain qui a inspiré les moines d’Orient dans la pratique de ce qu'on appelle la « philocalie », la prière du cœur : « Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi pécheur ». Cette invocation est encore aujourd’hui une source extraordinaire de libération et de joie pour tous ceux qui la prient.
Cher Olivier, je reprends volontiers pour vous les mots de l'apôtre Paul à son disciple Timothée : « Le Seigneur m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent ». En ce jour où vous êtes officiellement investi de la charge curiale, solidairement avec votre frère, le Père Bavon, accueillez cet encouragement de l’apôtre. Votre mission pastorale ne part pas de rien ; elle s'inscrit dans l'héritage des ministères accomplis par les prêtres qui vous ont précédés, spécialement, le Père Étienne Lafaye et le Père Pierre Téqui. Les prêtres se suivent et ne se ressemblent pas. Aussi, j’ai bien conscience qu’accueillir de nouveaux visages de prêtres est toujours un défi pour la communauté paroissiale. Alors, merci, mes amis, d’accueillir le Père Olivier et de veiller à sa personne aux côtés du Père Bavon. Et merci à nos frères diacres, Georges de Massia et René Sors, de porter avec eux la charge pastorale sous le patronage de saint Ferréol, patron de cette belle communauté de paroisses. "
Thierry Scherrer, évêque du diocèse de Perpignan - Elne.