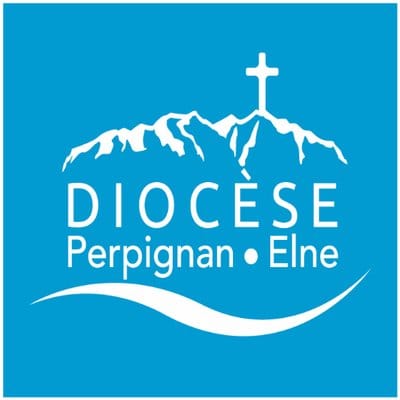Retrouvez l’homélie de l’évêque à l’occasion de la Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 2025, accompagnée de quelques photos de cette matinée de recueillement.
« Il y a soixante ans exactement, c’était le 4 octobre 1965, le Pape Giovanni Battista Montini s’exprimait à la tribune des Nations unies, lançant un vibrant appel contre la guerre à l’occasion du vingtième anniversaire de l’ONU et trois ans après la crise des missiles à Cuba qui avait porté le monde au bord d’un conflit nucléaire : « Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre! », avait-il lancé sur un ton pathétique. Et le pape Paul VI, car il s’agit bien de lui, ajoutait : « Écoutez les paroles lucides d'un grand disparu, John Kennedy, qui proclamait : ‘L'humanité devra mettre fin à la guerre, ou c'est la guerre qui mettra fin à l'humanité ».
Si nous sommes rassemblés, ce matin, dans cette cathédrale, c’est parce que nous sommes nous-mêmes habités profondément par cette conviction que la paix est toujours possible alors même que les appels à limiter la violence, les exhortations incessantes en faveur de la paix – qui sont une constante de l’action des Papes depuis des décennies –, restent le plus souvent impuissants face au fracas des armes. Il n’est que de considérer la gravité de la situation internationale dans laquelle nous nous trouvons. Elle concerne l’Europe, notamment à travers la guerre en Ukraine et les menaces russes contre d’autres pays de notre continent. Mais cette « troisième guerre mondiale par morceaux », comme l’appelait le pape François, n’en finit pas d’allumer de nouveaux foyers dans le monde, au gré des appétits insatiables des grandes puissances. Le cardinal Aveline le rappelait la semaine dernière dans son discours d’ouverture de l’Assemblée plénière des évêques de France : « La liste serait trop longue des pays actuellement en proie à la violence et à la guerre, du Soudan à la Birmanie, des Grands Lacs africains à la mer de Chine, des plaines du Sahel et du Sahara occidental aux montagnes de l’Afghanistan et du Pakistan, de la région du Proche-Orient à celle des Caraïbes, etc. » De façon inquiétante, nous le voyons bien, une nouvelle menace se fait jour, simplement parce que l'humanité semble avoir perdu la mémoire du passé récent.
Une autre conviction nous habite qui justifie également notre présence ce matin dans cette cathédrale : la paix véritable ne peut venir que de Dieu. Elle n'a qu'un visage, celui que lui a donné le Christ, lui qui a dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne » (Jn 14,27). Il n’aura échappé à personne que le 8 mai dernier, lorsque le Pape Léon XIV apparut pour la première fois à la loggia centrale de la basilique vaticane, c’est en émissaire de paix qu’il s’adressa à la ville et au monde : « La paix soit avec vous tous ! lança-t-il, en reprenant justement les mots de la salutation du Christ ressuscité aux apôtres. « Je voudrais que ce salut de paix entre dans vos cœurs, qu'il parvienne à vos familles, à tous les hommes, où qu'ils soient, à tous les peuples, à toute la terre. Que la paix soit avec vous ! C'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante, humble et persévérante. Elle vient de Dieu, de Dieu qui nous aime tous inconditionnellement ». Et le pape Léon d’imprimer progressivement sa marque en ce sens : le 11 octobre, il y a tout juste un mois, lors de la veillée de prière pour la paix qui avait lieu Place Saint-Pierre, il insistait : « La paix est désarmée et désarmante. Elle n'est pas dissuasion, mais fraternité, elle n'est pas ultimatum, mais dialogue. Elle n'adviendra pas comme le fruit de victoires sur l'ennemi, mais comme le résultat d'une semence de justice et d'un pardon courageux. » Il y a, derrière cette affirmation, l’idée déjà présente dans les prises de parole de son prédécesseur François, que l’armement lourd, en particulier nucléaire, est un danger permanent et qu’il faut par conséquent aller vers un désarmement nucléaire total.
Et puis le pape Léon vient confirmer et appuyer une autre conviction qui traverse toute la pensée sociale de l'Église : la paix ne saurait être réduite à l'absence de conflits, elle doit être envisagée comme un processus dynamique intégrant la justice sociale et le respect des droits humains. Tant que persistent les inégalités, la pauvreté et l'injustice structurelle, aucun espoir de paix n'est envisageable au plan mondial. On se souvient de cette formule forte du pape Jean-Paul II, à l'occasion de la 35e journée mondiale de la paix, en 2002 : « Pas de paix sans justice, pas de justice sans pardon ». La justice est la condition de la paix, une paix durable ne peut exister sans justice. Mais parce que la justice humaine est toujours fragile et imparfaite, elle doit être complétée par le pardon et la réconciliation qui guérissent les blessures et qui rétablissent en profondeur les rapports humains perturbés. Chercher une paix immédiate sans pardon ni justice ne peut que conduire à des accords superficiels qui voleront en éclats dès que les causes sous-jacentes du conflit réapparaîtront. Que saint Martin fêté en ce jour nous inspire les voies propices à la reconstruction de la paix et qu’il nous donne l’audace de les mettre en œuvre de manière effective et courageuse. Amen.»
Mgr Thierry Scherrer
Évêque de Perpignan-Elne